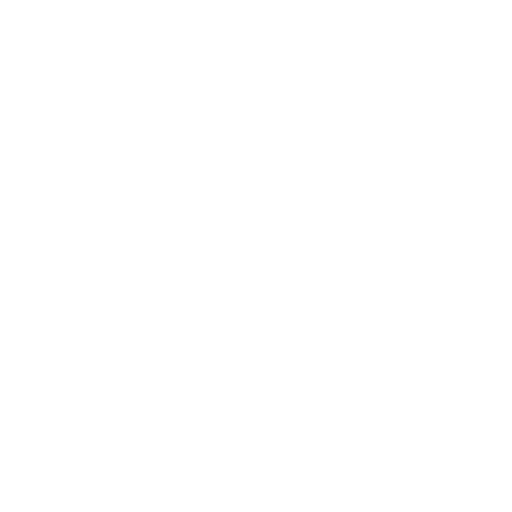Vous êtes ici
Back to topAPRNEWS : Qu'est-ce qui motive la délocalisation des banques françaises loin de l'Afrique ?

APRNEWS : Qu'est-ce qui motive la délocalisation des banques françaises loin de l'Afrique ?
En avril 2024, la Société Générale a conclu un accord de cession de ses activités au Maroc, regroupées sous la Société Générale Marocaine de Banques et ses filiales, ainsi que La Marocaine Vie, une compagnie d’assurances. Ces deux entreprises ont été rachetées par le groupe Saham, basé à Casablanca.
Et la Société Générale de justifier ce désinvestissement par l’exécution de la feuille de route stratégique présentée en septembre 2023, « visant un modèle d’entreprise plus rationalisé, plus synergique et plus efficace, tout en renforçant l’assise financière du groupe ». Cette décision fait suite à des décisions antérieures de vendre ses participations dans d’autres filiales africaines, telles que sa participation de 52,34 % dans l’Union Internationale de Banques, basée en Tunisie.
« Nous nous attendons à une plus grande inclusion financière et à un meilleur accès aux services financiers dans toute l’Afrique, car les banques africaines cibleront certains des segments qui n’étaient pas accessibles aux filiales des banques françaises. »
La vente des activités marocaines de la Société Générale intervient à un moment où de nombreuses autres banques françaises prennent des mesures similaires pour se retirer du marché africain.
Début mai, BNP Paribas, la plus grande banque de la zone euro, a annoncé qu’elle n’offrirait plus de services de banque d’affaires et d’investissement en Afrique du Sud, dans le cadre de ses efforts pour consolider ses activités européennes et asiatiques et se concentrer sur ses marchés principaux. La banque française a également vendu ses filiales au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Tunisie et en Côte d’Ivoire.
Il en avait été de même pour le Crédit Agricole. En avril 2022, la banque a vendu sa participation de 78,7 % dans sa filiale Crédit du Maroc à la société marocaine Groupe Holmarcom. Depuis, il a été rapporté que la banque française a chargé le cabinet de conseil financier Lazard de commencer à chercher des acheteurs potentiels pour ses sociétés en Tunisie, au Cameroun et au Ghana.
Jamal El Mellali, directeur de Fitch Ratings, explique que « les banques françaises se sont progressivement retirées de l’Afrique pour se recentrer sur des domaines où elles disposent d’atouts concurrentiels et dans des pays où les conditions d’exploitation sont plus conformes à leur appétit pour le risque ». Selon l’expert, « les marchés africains sont plus risqués et le niveau de rendement de leurs filiales, du point de vue des banques françaises, n’est souvent pas suffisant pour justifier leur présence ».
Des bénéfices en baisse, des coûts en hausse
Il est certain que les banques opérant en Afrique de l’Ouest francophone et au Sahel, où les banques françaises ont tendance à être les plus présentes, ont été exposées à un nombre croissant de risques au cours des derniers mois.
Par exemple, en février, Fitch Ratings a averti que la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger du bloc de la CEDEAO à la suite de coups d’État « pourrait avoir un impact négatif significatif sur leurs économies » et pourrait conduire à des tarifs commerciaux plus élevés, entraînant à leur tour une hausse de l’inflation, ainsi qu’une perturbation des chaînes d’approvisionnement et des flux de capitaux. Cela pourrait conduire à un plus grand nombre de prêts non performants et à une pression accrue sur les bilans des banques opérant dans la région.
Plus largement, la baisse de la rentabilité des banques africaines est une tendance à long terme, indépendamment des tensions géopolitiques et économiques croissantes qui exercent une pression supplémentaire sur leurs bilans. Selon McKinsey, depuis 2016, la rentabilité des cinq plus grands marchés bancaires africains – l’Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigéria et l’Afrique du Sud – a diminué en moyenne de 2 %.
Si les bénéfices à court terme ont probablement été stimulés au cours des deux dernières années, en raison d’un environnement de taux d’intérêt plus élevés, le tableau plus large est que les banques africaines sont confrontées à des marges de frais en baisse en raison d’une concurrence accrue et de la proéminence croissante des entreprises Fintech qui sont en mesure de fournir des services similaires aux consommateurs et aux entreprises pour des frais moins élevés.
L’analyse de McKinsey montre également que « les banques de la plupart des marchés africains ont des ratios coûts/revenus élevés, ainsi qu’une faible pénétration bancaire, par rapport aux marchés émergents de référence au Moyen-Orient, en Europe de l’Est, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine ».
Payer pour les nouvelles règles
M’khuzo Mwachande, banquier d’affaires au Cap, suggère que les coûts de conformité plus élevés réduisent également les bénéfices des banques en Afrique. « L’une des principales raisons pour lesquelles les banques françaises se sont retirées du marché africain est l’escalade des coûts de mise en conformité. » En effet, « les exigences réglementaires rigoureuses auxquelles elles sont soumises, en particulier dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d’argent, imposent des charges financières substantielles aux banques opérant sur le continent africain », ajoute M’khuzo Mwachande.
Cette baisse de rentabilité pose un problème particulier aux banques françaises, car les régulateurs internationaux obligent de plus en plus les institutions financières à renforcer leurs réserves de capital. À la suite de la crise financière mondiale de 2008, la Banque des règlements internationaux (BRI) a commencé à travailler sur les réformes de « Bâle III » qui visent à améliorer la réglementation, la supervision et la gestion des risques dans le secteur bancaire mondial.
L’idée centrale est d’améliorer les réserves de capitaux qui, selon Bâle III, devront représenter 2,5 % du total des actifs pondérés en fonction des risques plus 4,5 % des avoirs bancaires liquides. Ce, afin de garantir que les banques soient mieux positionnées à l’avenir pour faire face aux chocs. Les banques mettent en œuvre ces mesures depuis 2017, mais la réglementation entrera en vigueur à la mi-2025.
Il semble qu’un nombre croissant de banques françaises soient arrivées à la conclusion que les ventes d’actifs en Afrique sont un moyen de lever les capitaux supplémentaires nécessaires pour se conformer aux réglementations de Bâle III – d’autant plus qu’elles sont confrontées à une baisse de la rentabilité et à des marchés bancaires africains plus élevés dans tous les cas.
Jamal El Mellali juge que le retrait des banques françaises du marché africain pourrait entraîner quelques difficultés à court terme, mais qu’il sera en fin de compte positif pour la scène bancaire nationale du continent. « La sortie d’actionnaires étrangers puissants pourrait rendre l’accès au système financier mondial et aux banques correspondantes plus difficile pour les institutions africaines cédées », explique l’analyste de Fitch à African Business. « Cela pourrait entraîner des perturbations dans les transferts de fonds transfrontaliers, les paiements et les activités de financement du commerce. Sur de nombreux marchés subsahariens, où les liquidités en devises sont limitées, l’accès aux devises fortes pourrait également être plus difficile sans les lignes de liquidités en devises que les banques mères françaises fournissent généralement pour soutenir les activités de financement du commerce. »
Les régulateurs doivent agir
M’khuzo Mwachande ajoute que « les banques françaises jouant souvent un rôle important dans la fourniture de liquidités, l’absence soudaine de ces institutions pourrait peser sur le secteur bancaire, entraînant des pénuries potentielles de liquidités et des perturbations dans les flux de fonds au sein de l’économie ».
« Les régulateurs africains devront s’attaquer rapidement aux problèmes liés aux accords de correspondance bancaire afin de garantir une activité sans faille. En l’absence de relations de correspondance bancaire solides, les entreprises africaines risquent de rencontrer des difficultés pour effectuer des transactions internationales, ce qui pourrait entraver le commerce et la croissance économique. »
S’il faut s’attendre à quelques perturbations à court terme, nos interlocuteurs sont tous deux convaincus qu’il s’agit en fin de compte d’une évolution positive pour le marché bancaire national de l’Afrique. En effet, le vide laissé par le retrait des banques françaises pourrait « offrir des opportunités significatives aux banques locales et régionales en Afrique », juge Jamal El Mellali.
Nous avons déjà vu quelques signes de cette évolution. En décembre 2023, Standard Chartered a vendu ses activités de banque des particuliers en Côte d’Ivoire à Coris Bank, basée à Ouagadougou. La banque a également conclu des accords pour reprendre toutes les activités de la Société Générale au Tchad et en Mauritanie.
« Certains groupes bancaires aux ambitions panafricaines, comme Coris Bank International ou Vista Bank, qui ont acquis des filiales de banques françaises, devraient finir par acquérir suffisamment d’envergure pour concurrencer les institutions déjà bien établies », explique l’expert de Fitch. « Il existe un marché potentiel important qui n’a pas été exploité par les banques françaises en raison des normes de prêt strictes, ce qui offrira un fort potentiel de croissance aux banques africaines. »
Opportunités pour les banques nationales
Cette évolution pourrait à son tour améliorer la qualité et l’étendue des services bancaires offerts aux consommateurs africains. Le banquier M’khuzo Mwachande souligne que « le départ des banques françaises pourrait inciter les banques locales africaines à innover, notamment en répondant aux besoins spécifiques des consommateurs africains en matière de protocoles de connaissance du client (KYC) ». Sachant que « les banques internationales ont toujours eu du mal à s’implanter en Afrique parce qu’elles ont tendance à appliquer des normes et des produits bancaires occidentaux sans bien comprendre le marché local. Les exigences en matière de connaissance du client, qui requièrent une identification formelle, une preuve d’adresse et une preuve de revenu, constituent des obstacles importants pour de nombreux Africains ». Ainsi, une grande partie de la population n’ayant pas d’identité officielle et occupant des emplois informels, l’adhésion à des normes KYC strictes exclut-elle un grand nombre de personnes du secteur bancaire officiel.
« Toutefois, le retrait des banques internationales offre aux banques africaines l’occasion d’innover pour relever les défis liés à l’identification des clients. Au lieu d’adhérer de manière rigide aux exigences conventionnelles en matière de documentation, les banques africaines pourraient explorer des approches alternatives adaptées aux réalités africaines. »
Une approche plus adaptée aux conditions sur le terrain pourrait encourager les banques à être moins conservatrices dans l’offre de produits tels que les prêts, et libérer plus de capital pour l’investissement, suggère M’khuzo Mwachande. « Les banques africaines pourraient finir par mieux servir les secteurs formel et informel de l’économie, ce qui permettrait d’améliorer l’accès au crédit pour les entreprises en croissance et de stimuler l’esprit d’entreprise et le développement économique sur l’ensemble du continent. »
Jamal El Mellali est également convaincu qu’à long terme, les banques locales seront mieux placées pour répondre aux besoins.
« Nous nous attendons à une plus grande inclusion financière et à un meilleur accès aux services financiers dans toute l’Afrique, car les banques africaines cibleront certains des segments qui n’étaient pas accessibles aux filiales des banques françaises en raison d’une appétence plus stricte pour le risque. Les PME, dont l’accès au crédit est souvent limité, seront l’un des bénéficiaires. »
@AB