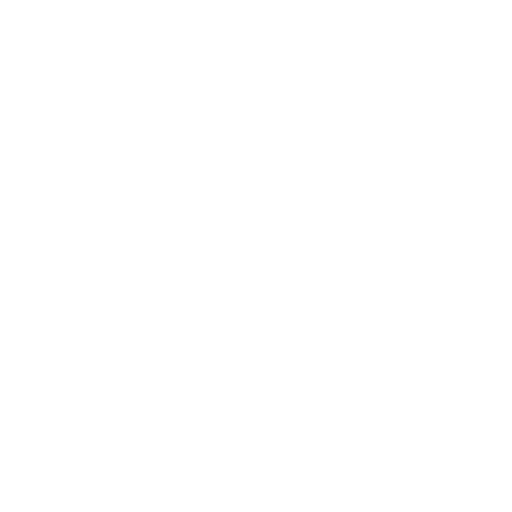Vous êtes ici
Back to topAPRNEWS - Afrique : le difficile combat des féministes face aux violences sexuelles

APRNEWS - Afrique : le difficile combat des féministes face aux violences sexuelles
Quand elle marche dans les rues de Conakry, Kadiatou Konaté se méfie des regards insistants. Parfois, un doigt se pointe vers elle. « C’est vous qui envoyez nos hommes en prison ? », l’apostrophe parfois une voix hargneuse. La militante féministe répond invariablement « non », par peur d’être agressée.
A 21 ans, Kadiatou Konaté dérange une société guinéenne gangrenée par les violences sexuelles. Avec son modeste bataillon de 500 militantes réunies au sein du Club des jeunes filles leaders de Guinée, Kadiatou Konaté est en guerre contre les crimes sexuels, un phénomène massif dénoncé dans un récent rapport d’Amnesty International. En 2009, lors d’une enquête nationale, 23 % des Guinéennes déclaraient avoir été violées. 97 % des filles et adolescentes ont aussi subi l’excision, pratique pourtant illégale depuis vingt ans.
Comme d’autres féministes d’Afrique subsaharienne francophone, Kadiatou Konaté, engagée dès ses 15 ans dans des associations de défense des femmes, n’a pas attendu le mouvement #metoo pour prendre la parole. Agées de 20 à 33 ans, les militantes incarnent la nouvelle génération – parfois la troisième, selon les pays – à avoir investi les luttes féministes. Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Cameroun, Bénin… depuis plusieurs années, elles dénoncent les atteintes au corps et aux droits des femmes. Et partout elles font face à une violente réaction. Leur prise de parole, surtout numérique, témoigne d’une politisation massive des jeunes Africaines. « Bien sûr #metoo a résonné en nous. Mais si les filles prennent conscience des oppressions qu’elles subissent, c’est le fruit de l’accès à l’éducation de masse. Une victoire qu’on doit à nos aînées », estime la militante béninoise Chanceline Mevowanou.
Néanmoins, les féministes africaines se sont approprié le mouvement surgi il y a cinq ans en lançant des campagnes en ligne, avec plus ou moins de succès. Au Sénégal, en 2018, à la suite d’une série de viols et de féminicides, Ndèye Fatou Kane, chercheuse et féministe, a créé #balancetonsaïsaï. Au pays du « sutura », l’injonction au silence, l’adhésion fut timide mais l’initiative a fait date.
Une rupture générationnelle
Le hashtag #vraiefemmeafricaine, grinçante parodie des clichés accolés à « l’authentique » femme africaine, lancé en 2020 par la journaliste ivoirienne Bintou Mariam Traoré, s’est massivement propagé dans le monde francophone. « Cette campagne a été notre #metoo. Elle a permis de montrer aux Africaines en quoi le féminisme était libérateur », explique Méganne Boho, présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes.
Peut-on pour autant parler d’une révolution féministe en Afrique francophone ? Le chemin semble encore long pour nombre de militantes. La prise de parole, bien qu’émancipatrice à l’échelle individuelle, n’a pas fondamentalement bousculé les structures patriarcales génératrices d’oppression. Les rapports de dominations se sont maintenus dans les sphères de pouvoir.
Ainsi, au Sénégal, l’affaire Adji Sarr, nom de la masseuse qui a accusé en mars 2020 Ousmane Sonko, le principal opposant au président sénégalais, de viols répétés – ce que ce dernier nie –, illustre l’impossible débat sur le sujet. Le scandale, perçu comme un complot d’Etat, a enflammé le pays, 14 personnes ont été tuées dans des manifestations de soutien au responsable politique mis en cause. L’affaire a également dévoilé une rupture générationnelle. Contrairement aux plus jeunes, les pionnières, structurées et influentes, ont mollement soutenu la victime présumée, par peur du climat de violence. Elles s’étaient aussi montrées plus prudentes que les jeunes militantes face à la parole d’Adji Sarr. L’instruction de cette affaire est toujours en cours.
Par ailleurs, même si certains pays ont renforcé leur arsenal juridique – au Sénégal, le viol est criminalisé depuis 2019, en Guinée, les peines ont été alourdies –, l’impunité persiste. « La loi sénégalaise continue de réclamer que la victime prouve qu’elle n’était pas consentante. Elle ne bénéficie pas non plus d’aide juridictionnelle, contrairement à l’auteur présumé », dit Ndèye Khaira Thiam, psychologue clinicienne et criminologue. Dans ce contexte peu favorable aux droits des femmes, tenter de renverser l’ordre se paie au prix fort.
Climat de violence
« Mon engagement féministe a fichu ma vie en l’air. Il m’a coûté mon boulot, ma quiétude, ma liberté de circuler où je veux et quand je veux », confie Gabrielle Kane. La trentenaire sénégalaise, connue pour avoir publiquement soutenu Adji Sarr, continue de décocher sans retenue ses flèches sur les plateaux de télévision. Et récolte des flopées d’insultes et de rares encouragements. En juin, l’un de ses détracteurs a toutefois été condamné à six mois de prison avec sursis pour menaces de mort.
L’ancienne mannequin, à la tête d’une agence de communication, est la cible favorite des antiféministes. Ils l’accusent d’accointances avec les hommes du régime, d’être au service de la France – où elle a vécu dix ans – et de vouloir détruire les fondements de la société sénégalaise. Une critique récurrente à l’égard de ces femmes, accusées d’être des « suppôts » de l’Occident. « Je ne me tairais pas même si je me sens en danger », affirme pourtant la jeune femme, placée, pour la deuxième fois en deux ans, sous protection policière.
« Epuisées », et « découragées », les féministes francophones sortent souvent abîmées de ce climat de violence. Cruel paradoxe, elles se retrouvent submergées par des demandes d’aide de victimes dont elles ont encouragé la prise de parole. « Je me couche et je me lève avec des messages d’appels à l’aide de femmes qui me racontent les violences qu’elles subissent. Au bout d’un moment, je craque », reconnaît Kadiatou Konate.
Investir dans des espaces de guérison
De fait, burn-out et dépressions attaquent la santé mentale des militantes, sommées de combler les carences de leur Etat en matière de prise en charge des survivantes. Pour y faire face, au sein des collectifs, la question du « care » (soin) est désormais prise au sérieux. L’Ivoirienne Méganne Boho, à la tête d’une association de 85 personnes, a dû se résoudre à consulter une thérapeute, également présente pour l’équipe. « Recevoir cinq appels à l’aide par jour, dont au moins deux pour viol, c’est lourd à porter. Toute cette détresse nous dépasse, d’autant que nous sommes bénévoles. »
Sa consœur béninoise Carine Danhouan, elle, s’interroge sur la survie du mouvement : « Nos militantes sont blessées. Il y a urgence à investir dans des espaces de soin et de guérison. Sinon, elles vont vriller. On ne peut pas aider si l’on souffre soi-même. »
A ces enjeux cruciaux, s’ajoute un obstacle majeur pour la nouvelle génération féministe : la résurgence des mouvements religieux, qui suscite de forts tiraillements. « Au Sénégal, notre plus grand défi est de nous attaquer aux interprétations fallacieuses que des pseudo-religieux font du Coran pour continuer à contrôler le corps des femmes », explique Maimouna Astou Yade. Celle qui revendique un féminisme « radical » et ancré dans l’islam ne rejette pas la polygamie, pratique fustigée par la plupart des pionnières. « Si les hommes respectaient les conditions requises par le Coran, la polygamie ne serait pas source de violence. Mais ils les bafouent pour mieux contrôler les femmes », assure cette juriste.
« La plupart des féministes sénégalaises vivent une ambiguïté fondamentale. Elles réclament des droits mais ne souhaitent pas déconstruire le système patriarcal qui les oppresse, juge pour sa part Ndèye Khaira Thiam, psychologue clinicienne et criminologue. La plupart ne sont pas prêtes à vivre librement car elles aspirent au mariage, qui est pourtant la porte de leur prison. Car selon le code de la famille, l’homme détient la puissance maritale sur sa femme et ses enfants. » La révision de ce texte demeure l’un des combats de certains mouvements féministes.
La clinicienne dénonce également le « silence » des militantes concernant les droits des travailleuses du sexe ou des minorités sexuelles, véritable angle mort des combats féministes en Afrique francophone. « Alors qu’il y a quarante ans, les féministes portaient le débat sur ces questions, elles s’en sont désengagées, laissant le champ libre aux islamistes, qui réclament, eux, le durcissement de la loi contre l’homosexualité. Pourtant, vouloir imposer une norme hétérosexuelle, c’est aussi chercher à contrôler le corps des femmes », poursuit Ndèye Khaira Thiam.
Passer le flambeau à la nouvelle génération
Rejetées par le corps social pour le risque de déstabilisation qu’elles inspirent, les organisations féministes doivent aussi se battre pour survivre. L’argent des bailleurs de fonds favorise certains pays – le Burkina Faso, le Sénégal ou le Niger – et en néglige d’autres, comme la Centrafrique, la République démocratique du Congo (RDC), pays où le viol est utilisé comme « arme de guerre ». Elles sont aussi en concurrence avec les ONG des pays anglophones, grands bénéficiaires de l’aide internationale. « Les appels d’offres pour obtenir des financements, la documentation, les conférences, tout est en anglais ! Nous n’avons pas les mêmes opportunités qu’elles car nous ne maîtrisons pas toujours la langue », regrette la juriste camerounaise Caroline Mveng.
Pour faire face au rouleau compresseur anglophone, les féministes de langue française tentent lentement de se fédérer en réseau transnational. Les passerelles avec leurs consœurs demeurent ténues. « Elles nous reprochent d’être en retard car nous en sommes toujours aux questions de violences domestiques quand elles se battent pour les minorités sexuelles », poursuit Caroline Mveng.
Des disparités qui se retrouvent aussi dans la production scientifique. Alors que les Kényanes, les Sud-Africaines et les Ghanéennes disposent d’une riche production scientifique pour penser le féminisme à partir de leur contexte socioculturel, les jeunes militantes francophones en sont dépourvues. « Pourquoi ne pas valoriser l’expertise autre qu’universitaire ? Elle est disponible mais dévalorisée dans nos pays. Ce savoir est indispensable pour ancrer politiquement notre féminisme et sortir d’une lutte centrée sur la réaction à la violence », estime la Camerounaise Françoise Moudouthe, à la tête du Fonds africain pour le développement de la femme.
Malgré ces obstacles, les féministes francophones espèrent passer le flambeau à la nouvelle génération. Avec une mission cruciale pour assurer la survie du combat, avertit Chanceline Mevowanou : « Pour dépasser le stade embryonnaire dans lequel se trouve le féminisme en Afrique francophone, nous devons mettre nos forces dans l’éducation dès le plus jeune âge afin de démanteler à la racine, les oppressions systémiques. Sans cela, il n’y aura pas de réelle révolution féministe. »
Source : Le Monde Afrique